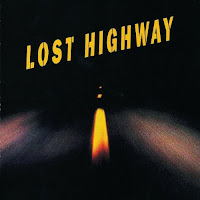Ce rockumentaire ne vous apprendra rien de vraiment nouveau sur les Doors, à moins que vous ne connaissiez pas grand chose de ce groupe. Mais justement, pour ce qui ne connaissent pas grand chose à ce groupe, je ne peux que vous conseiller, si vous deviez choisir entre le biopic d'Oliver Stone et le travail de Tom DiCillo (qui répond là pourtant à une commande de la maison de disque), de choisir ce dernier, tant on est ici à mille lieues de l'iconisation et de la romantisation du frontman indéniablement charismatique qu'était Jim Morrsion.
Et s'il est impossible de séparer l'histoire de la carrière du groupe de celle du Roi Lézard, DiCillo et son narrateur (Johnny Depp, au poil) ont l'intelligence de raconter ces deux histoires, intimement liées, et de nous rappeler (et il le savait) que Morrison n'était rien sans les trois autres, et inversement, sans condescendance ni . Le point fort de ce documentaire est aussi de nous rappeler toujours le contexte de ces 4 ans et des poussières qu'a duré la carrière des Doors, ce groupe jamais très politisé mais trainant une aura de souffre et de liberté, pleinement dans son époque et conscient de celle-ci.
Étrange carrière pour un groupe à part, sans vraiment de descendance, de ce conglomérat hétéroclite d'horizons (jazz, classique, flamenco, poésie, magie...), et When You're Strange en est la trace, le bel hommage juste et simple, loin des clichés sulfureux qu'Oliver Stone, lui, avait aimé grossir dans son biopic. Ici, au fond, c'est plutôt la musique et non les faits divers qui entraine le film et n'est-ce pas, au final, ce qui restera des Doors ?
Pour l'anecdote, j'ai été amusé de voir à la production de ce documentaire un certain Dick Wolf, que je connaissais plutôt comme producteur du pénible univers sériesque des Law & Order (New York Unité Spéciale, Section Criminelle, etc...). Il semblerait que ce même Dick Wolf soit un fan absolu des Doors et qu'il n'a pas hésité une seconde à produire quand il a su que le documentaire se montait. Merci donc à Law & Order, d'une certaine manière !
Et s'il est impossible de séparer l'histoire de la carrière du groupe de celle du Roi Lézard, DiCillo et son narrateur (Johnny Depp, au poil) ont l'intelligence de raconter ces deux histoires, intimement liées, et de nous rappeler (et il le savait) que Morrison n'était rien sans les trois autres, et inversement, sans condescendance ni . Le point fort de ce documentaire est aussi de nous rappeler toujours le contexte de ces 4 ans et des poussières qu'a duré la carrière des Doors, ce groupe jamais très politisé mais trainant une aura de souffre et de liberté, pleinement dans son époque et conscient de celle-ci.
Étrange carrière pour un groupe à part, sans vraiment de descendance, de ce conglomérat hétéroclite d'horizons (jazz, classique, flamenco, poésie, magie...), et When You're Strange en est la trace, le bel hommage juste et simple, loin des clichés sulfureux qu'Oliver Stone, lui, avait aimé grossir dans son biopic. Ici, au fond, c'est plutôt la musique et non les faits divers qui entraine le film et n'est-ce pas, au final, ce qui restera des Doors ?
Pour l'anecdote, j'ai été amusé de voir à la production de ce documentaire un certain Dick Wolf, que je connaissais plutôt comme producteur du pénible univers sériesque des Law & Order (New York Unité Spéciale, Section Criminelle, etc...). Il semblerait que ce même Dick Wolf soit un fan absolu des Doors et qu'il n'a pas hésité une seconde à produire quand il a su que le documentaire se montait. Merci donc à Law & Order, d'une certaine manière !